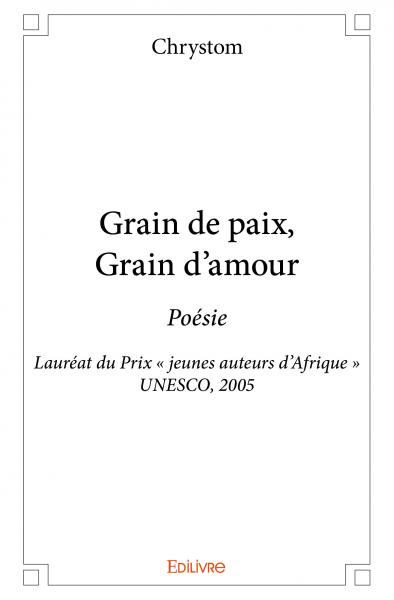Posté par
Flora
Rencontre avec Chrystom, auteur de « Grain de paix, Grain d’amour »
 Chrystom, où habitez-vous ?
Chrystom, où habitez-vous ?
Pour répondre à votre question, force est de faire observer d’emblée que je ne suis pas casanier. La vie casanière est assez morne, si amère et peu féconde. Ambitionner de partir est un rêve qualitatif, me semble-t-il, puisque le voyage forge : heureux qui comme Ulysse a voyagé, scandait Du Bellay. Ce n’est donc pas être fugitif que de partir, intérieurement ou extérieurement. J’ai quitté mon pays natal, le Congo, pour l’Occident, grâce à une bourse du gouvernement français. Depuis, ma vie est un long voyage qui m’a conduit dans un espace triangulaire symbolique : de l’Afrique à l’ Europe, de l’Europe aux États Unis. Finalement, j’ai posé mes bagages en France, terre d’ancrage, nouvelle patrie ; et actuellement je vis dans le Sud ouest, plus précisément à Pau.
Dans un de vos poèmes, il est d’ailleurs question du gave de Pau. Simple coïncidence ?
Au moment où je l’ai écrit, je ne savais pas qu’un jour je passerai du temps dans cette ville bâtie au pied des Pyrénées, ville dans laquelle séjourna également Afred de Vigny, auteur du poème « Cor », entre autres, et du roman Cinq-Mars pour lequel Hugo, chef de fil du Cénacle, tiendra des propos élogieux et mémorables: « La foule, affirmait-il, le lira comme un roman, le poète comme un drame, l’homme d’État comme une histoire ». De même, j’ignorais complètement que je me rendrai à Silver Sprint, une ville du Maryland que je citai dans le poème intitulé « Attente ». En ce sens, mon écriture précède parfois la réalité, la plume se faisant voyante à mon insu, tantôt incantatoire tantôt envoûtante, comme pour s’inscrire dans la logique rimbaldienne, sans doute par la force de Zambia Mpungu, le Dieu que priaient déjà les bantous avant l’arrivée des missionnaires en robe qui, en passant, n’ont pas apporté la position d’accouplement qu’on leur attribue, puisqu’elle était pratiquée depuis longtemps, très longtemps, certainement à l’époque de Lucie ! Ce Dieu, est celui de tous les dieux africains, y compris legba le dieu du vaudou, y compris celui des adorateurs du Lemba. Pour revenir à Pau, j’ai un lien très affectif avec cette ville qui a vu naître le bon roi Henri IV. Vous vous demandez quel rapport y a-t-il entre moi et ce roi ? Rassurez vous, ce n’est pas à cause des Coucougnettes qui font danser les palais et que tous les palois adorent, à priori. En fait, ma mère est protestante de confession et mon père catholique ; je suis né d’un mariage de religions ; ma famille est l’une de celles qui témoignent de la bonne concorde œcuménique. Or, comme vous le savez manifestement, Henri IV est celui qui a permis aux protestants de France d’exercer librement leur culte en prenant l’Édit de Nantes. Vous savez aussi fort bien ce qu’il en advint lorsque cet Édit fut remis en cause par Louis XIV ; les affaires Calas et Sirven attestent de la violence inouïe à laquelle les protestants firent face : soit c’était la reconversion au catholicisme, soit il fallait « s’exiler », soit c’était la tombe ! Vous comprenez pourquoi mon attachement à cette ville…
Est-ce que le poète que vous êtes est en exil ?
Non, contrairement à un ami érythréen qui dit être en exil ! Je dirais plutôt que je suis en voyage. Tous les écrivains sont en voyage, n’est-ce pas ? Voyage sinon dans l’espace géographique, du moins en soi. Les vrais exilés, je faisais remarquer à cet ami, sont les dictateurs : ils se coupent de la réalité du peuple, s’exilent dans leur bunker, leur forteresse, leur palais. Quand ils emprisonnent les preneurs de parole, ils ignorent que la véritable prison est en eux. Un écrivain vivant dans une démocratie est mille fois plus libre qu’un despote qui s’enterre dans son despotisme, enraciné et végétant sur son trône, pris à son piège, voyant partout, et en tous, le diable récidiviste qui essayerait de l’étrangler, lui qui distribuerait la misère, la souffrance, l’oppression et la mort à tour de bras, dans un élan de passion machiavélique… Pour mon compte, je n’ai jamais pensé que Soljenitsyne était en exil en Amérique; c’est plutôt le petit père du pouvoir totalitaire soviétique. Je n’ai jamais considéré que Voltaire était en exil en Angleterre ; c’est plutôt le tout puissant noble Chevalier de Rohan. Je n’ai jamais songé que Lafferrière était en exil, à une certaine époque; mais plutôt les Duvalier père et fils. Les mots n’ont pas toujours le sens du laboratoire académique qu’on leur connaît ; ils ont aussi le sens qu’on veut leur donner, leur destin est dans la bouche du peuple. Et le poète a tout un peuple en lui qui donne un nouveau sens aux mots anciens, quand il ne donne pas des mots nouveaux à la langue ; oui, un peuple souffrant le bâillonnement, étouffeur de cris, qui poussent à l’écrit ; c’est parce qu’il est blessé que saigne le crayon de l’artiste, ventilateur de la douleur. Il faut apprendre à retourner le fusil contre le fusilleur, pour cesser de subir le poids des mots violents, le châtiment psychologique du diktat de leur sens figé dans lequel on les enferme et qui case les concernés dans le fatalisme. Tandis que les tyrans se tuent à faire la géopolitique, le poète, cet ouvrier de la parole qui forge le langage et le contre-langage, fait la géo-poétique ; tandis que les premiers, souvent promoteurs du culte de l’inculture, s’arment de matraques et de mitraillettes pour ouvrir le feu sur des innocents, le poète s’arme de plume, pour seule arme, afin d’accourir : il ne saurait être impassible, atone, indifférent devant le chaos institutionnel, social, économique…
Présentez-nous votre ouvrage
Grain de paix, Grain d’amour est un recueil de poésie composé de soixante-cinq poèmes. Il se caractérise par deux thèmes fondamentaux, de plus en plus prenants, paraît-il, à mesure que l’on tourne les pages : celui de la guerre, avec son digne antonyme paix , sans vouloir convoquer Tolstoï qui signa Guerre et Paix ; et celui de l’amour. Amour aux trois sens : amour agapé, amour philia et amour éros, autrement dit l’amour du prochain, l’amitié et l’amour charnel, celui du désir appelant le contact.
A l’heure où certaines régions du monde sont à feu et à sang, dans un climat quasi-apocalyptique, enguirlandé en filigrane de prémices d’une troisième guerre mondiale encore larvée, cet ouvrage braque les projecteurs sur l’universalité humaine de la condition ; il s’intéresse à l’homme universel, à travers l’homme dit de couleur, à son état peu changeant en fonction de l’époque, de l’expérience, de l’histoire. C’est la voix du poète qui s’acharne à ne pas vouloir être enfermé aussi bien dans une certaine condition que dans une certaine définition ; une voix qui appelle de tous ses vœux la paix entre les hommes, laquelle paix n’est pas inaccessible.
Pourquoi avoir écrit ce livre ?
Plusieurs raisons concourent à sa réalisation. Chaque fois que l’Homme a connu une guerre, il s’est écrié : « plus jamais ça ! ». Après la première Guerre mondiale Jean Giraudoux écrivait La guerre de Troie n’aura pas lieu, une pièce de théâtre inspirée de l’épopée d’Homère, L’Illiade, mais qui mettait en garde contre une nouvelle guerre. Résultat des courses, la deuxième Guerre mondiale a bien eu lieu, ce qui conduira d’ailleurs Paul Valery à parler de Crise de l’esprit. Je cite ces grands noms parce que ce qui compte pour moi ce n’est pas tant le devoir de mémoire – qui, au passage, se réalise en Afrique par l’ancestral bouche à oreille tant la tradition orale est encore très forte – que le devoir d’histoire. L’histoire devrait permettre à l’humanité de ne pas recommencer les mêmes stupidités qui débouchent irrémédiablement sur des situations terriblement outrageuses, sanglantes, macabres. Ce qui est vrai pour l’ensemble de l’humanité l’est aussi au niveau africain. Quand on a connu trois conflits armés, on ne peut pas ne pas tirer la sonnette d’alarme, alerter les générations futures sur la nécessité de se battre pour la liberté et la paix : elle ne sont jamais acquises définitivement !
C’est donc, avant tout pour ne pas oublier que j’ai écrit chacun des poèmes, souvent à la lumière convalescente de la bougie, par manque criard d’électricité : ne pas oublier d’où je viens ; ne pas oublier que je ne dois pas plonger dans un embourgeoisement, disons embourgeoisement oublieux face à la misère ; ne pas oublier que la vie ne tient qu’à un fil, et se dire parfois Carpe Diem comme Horace sans toutefois perdre la lanterne de la lucidité ; ne pas oublier qu’un de mes amis est mort d’une mort crapuleuse, alors qu’on était en pleine conversation, abattu à bout portant sans qu’aucune enquête ne s’en suivît ; ne pas oublier qu’il faut armer le verbe insurgé pour aller à la conquête de la liberté ; ne pas oublier que le cycle de la vie est vicieux sans amour, sel de l’existence ; ne pas oublier l’amour des livres, l’amour des mots, l’amour de la nature qui, selon Baudelaire, est un lieu sacré et symbolique que seul le poète, intermédiaire entre elle et le commun des mortels, comprend mieux, dans un élan de correspondance poétique.
C’est par ailleurs, pour ne pas crever la bouche fermée et pour rendre au monde les paysages de mon âme que ma poésie est à la portée des pages. Elle n’attend plus qu’ à entrer dans la vie de son lectorat.
Au-delà de ce que j’ai avancé, s’illustre l’envie irrésistible de franchir les murs du recroquevillement sur soi, de revendiquer un lendemain post-éthnique, post-racial… mais aussi d’enfoncer le clou de mon existence en tant qu’auteur en herbe dans l’univers littéraire…nonobstant la saine rage insoupçonnée de changer l’avis et fermer définitivement la margoulette de quelques mégères aux commérages vexants qui, au cours de mon enfance et adolescence, ne lisaient en moi qu’un inutile pauvre hère avachi sur un tabouret de fils de marchande fait pour vendre des cacahuètes, alors qu’en même temps, dans ces ténèbres matures aux racines boueuses de mon jeune âge au fond desquelles l’écriture se réveillait comme seule lumière venant de l’intérieure, je tricotais les poèmes, sans songer qu’un jour ils entreraient dans la lumière du public, quoique ce fut un peu plus tard un souhait ardent. En fait moi, c’est l’histoire de celui que personne n’attendait !
Vous insistez souvent sur le travail de la langue, la qualité de l’écriture. Qu’est-ce qui fait la particularité de ce recueil? Quel est le style chrystomien ?
Je laisse le soin à ceux qui manient, avec un sens clinique, le scalpel de l’analyse… Pour ma part, je me contenterai d’émettre quelques observations. C’est Victor Hugo qui affirmait avec force que la forme c’est le fond qui remonte à la surface. Pour saisir le sens et la quintessence d’un texte littéraire, il faut avoir à l’esprit que la langue n’est pas seulement un instrument de communication pour l’écrivain mais avant tout un outil de création. Cela est encore beaucoup plus vrai lorsqu’il s’agit de la poésie. Un travail du langage poétique s’impose . C’est pourquoi vous découvrirez, par exemple, dans ce recueil une poétique de la juxtaposition des phrases qui s’écartent du processus de progression logique ; il résulte de ces phrases-wagons connectées ou branchées un effet de simultanéité( « Âme du vide »).Certains poèmes sont marqués par l’une des ressources classique de l’expressivité « ô », sans toutefois la placer systématiquement en tête de vers de l’attribut adjectival. Il y a aussi un effacement structurel de certaines liaisons syntaxiques renforcé par la suppression de la ponctuation ; ce travail langagier apporte au vers un rythme de liberté qui donne parfois l’impression que les mots courent en même temps que galope le personnage fuyant la monstruosité des balles. Et en parlant de liberté, vous avez affaire à des vers libres caractérisés tantôt par un glissement de niveau de langue, tantôt par une métrique très disloquée, que je me plais à construire en dents de scie, et parfois sous une forme proche du calligramme (« Vent de paix », « Mère, mains et mélopée »). Le chant du renouveau fondé sur la structure, l’esthétique poétique et la rencontre des univers surgit des diverses vies éparses, morcelées quelquefois mais qui convergent, se rejoignent, comme des affluents : la vie de citadin, la vie de campagnard, la vie d’errant, de sinistré, d’autochtone, autour de la beauté bucolique, pastorale ou urbaine…redonnée, retranscrite par la création derechef du poète qui transforme l’obscurité en lumière, la bouse en énergie, les choses laides en mots auréolés, et les mots auréolés donnent naissance à leur tour à quelque chose d’exceptionnel, apparaissant à la conscience du lecteur, comme par magie…C’est cela l’art : le fait de nommer fait naître ! Quand Mallarmé écrit « Fleur », notre esprit est caressé par une musicalité, une suavité, une belle image de cette absente de toutes gerbes ! La bave du crapaud n’atteignant jamais la blancheur de la colombe, les événements observés deviennent, comme par alchimie, des mots ; puis les mots créent des images et des sons communicables ; le poète passant alors pour le passeur de la beauté recherchée; par son acte, le silence des cercueils enfouis sous-terre trouve écho outre-tombe, s’invitant dans le recueil, et le chant sonne le tocsin en guise de dernier recueillement ; il insuffle la vie aux ombres exhalant le parfum des morts, et des vies ressuscitent ; il fait surgir le passé, et le temps perdu est retrouvé ; il transfigure les figures brûlés de ses souvenirs, à la lumière insaisissable de sa vividité, et le temps retrouvé apaise…Le poète s’opère intérieurement comme on opère une chirurgie…pour la réalisation d’une cartographie de paix intérieure.
On remarque que certains poèmes font caisse de résonance.
Oui, ils entretiennent quelques liens de contiguïté, le tableau poétique obéissant moins à une logique d’éclatement qu’à une continuité thématique. Cela s’est constitué très naturellement, indépendamment de toute obligation d’unité. Par contre, je ne peux nier qu’il y a manifestement une architecture plus ou moins visible du livre, l’effet cadre est bien tangible dans ce recueil, en ouvrant le volume par « Vies au bout du fusil » et en optant pour « Fantômes, cauchemar » en position finale : des vies achevées à coups de fusil ; coups de fusil qui font être des fantômes, comme on fait être des enfants, et donnent des cauchemars, comme on donne la main à l’autre. Et la boucle qui devrait être bouclée ne l’est pas ; les points de suspension finaux laissent place à une interrogation existentielle ; ainsi, du premier au dernier poème, se crée une métaphore du serpent qui relâche sa queue après l’avoir longtemps mordue. Nul ne sait que devient le sinistré errant ! Ces deux textes, incipit et excipit, deviennent des pendants ; ils suscitent des questionnements à travers leurs tonalités qui se répondent tout en opérant une rupture esthétique, notamment sur l’angle énonciatif : le premier poème, l’initial, moins intimiste, est largement moins lyrique que le dernier, que je qualifierais de poème-errance où l’on découvre le sinistré solitaire. Cette situation formelle crée une différence résultant notamment de la présence indiscrète du locuteur dans celui-ci et sa quasi absence dans celui-là. Subjectivité interruptive ci, en clôture du volume ; gommage de la subjectivité là, dans le poème-incipit qui dresse un panorama de la réalité dramatique vécue pourtant par le poète, le tableau brossé vibrant dans ce dernier cas d’un effet impersonnel, du moins quasiment – parce qu’il y a moins de modalités assertives, et on note un abandon des pronoms déictiques ; on assiste à un anéantissement de lexèmes axiologiques, soustraction des lexèmes affectifs, absence de modalités interrogatives et injonctives, élimination des formes temporelles autres que le présent.
Dans l’entre-deux poèmes, incipit et excipit aux tons désespérés, gravitent certains textes qui servent de contrepoint afin d’établir un équilibre entre le dramatique et l’utopie, entre la férocité de la vie de brasier et le comique, entre le sérieux et la fantaisie. Construction qui offre un contrebalancement du sentiment élégiaque par des pièces porteuses d’un agréable vent de dédramatisation, de dérision, d’autodérision et d’espérance, des pièces dépouillées de flammes vives et mordantes de la souffrance de guerre ou d’amour. Il en va ainsi des textes portant respectivement sur l’expression du sentiment amoureux ou l’hymne à l’amour (dans « Marche », « Baiser aquatique de noce », « Un jeu d’amour », « Mendiant d’amour », « J’aimerais », « Âme du vide »…), le chagrin d’amour ( dans « Noire attente »…), le désir charnel (dans « Confession »…), la timidité ( dans « Timidité »), le pardon (dans « Écho du pardon »…), le déclin de la petite industrie qui conduit les pays en développement de plus en plus vers le sous-développement (dans « Industrie du rez-de-chaussée »), l’amour du livre, le cycle de la vie, la jeunesse, l’affection pour la grand-mère…Les pièces mélancoliques sont colorées de couleurs flamboyantes puisées indirectement à la source de la vie sociétale, du folklore quotidien et même des proverbes. Ainsi naît un nouvel univers lyrique où le fantastique, l’onirique et le merveilleux tranche parfois avec le réel !
À quel lecteur s’adresse votre ouvrage ?
A tous les fantassins de la littérature. Eux sans qui aucun livre n’irait à l’assaut des continents, même pas celui culte d’un des plus grands, des plus illustres écrivains morts. Là où le tyran mettrait en ordre de marche son impitoyable armée de chars pour imposer son pitoyable livre au peuple, l’écrivain n’a pas d’autre choix que de voir en son lectorat son plus grand complice, par qui seul il vit. N’étant pas de ceux qui tiennent mordicus la bride de l’exclusivisme, ce livre est donc à ceux sans qui les livres n’existeraient pas : les lecteurs ; tous les lecteurs à qui il parlera ; les lecteurs sans exclusion ; tous les lecteurs éclectiques en littérature ; et pas seulement aux amateurs de poésie, qui ont tout mon respect et toute ma gratitude ! Ma parole n’est pas seulement destinée aux africains ou aux francophones. Que ceux qui ont la possibilité de le lire le lise. Et en parlant de lecture, une petite confidence. Personnellement, je suis né dans une maison où il n’y avait qu’un seul livre : la Bible, en plusieurs versions ! Ma première vraie expérience d’abonné aux livres, je la dois à ma mère, une marchande, à qui les gens venaient vendre du papier et des livres destinés à l’emballage des produits commerciaux. En toute franchise, je ne supportais pas la déchirure des livres ; chaque page arrachée était un arrachement du cœur ; je convainquais ma mère de les mettre à ma disposition, et quand je ne parvenais pas par l’argumentation, je les soustrayais furtivement, sans me faire remarquer, et puis quand je me faisais avoir je m’agenouillais en la suppliant de me laisser tranquillement voyager à travers ces pages écrites qui me faisaient découvrir d’autres lieux, d’autres peuples, d’autres contrées, d’autres panoramas de l’âme. Il faut cependant souligner que la plupart de ces livres n’étaient pas complets ; c’est ainsi que sont tombés entre mes mains, entre autres, Les Fleurs du Mal, Mille lieues sous les Mers, Les chants de Maldoror, Les Misérables, sans savoir qu’ils étaient respectivement l’œuvre de Hugo, Lautréamont, Jules Verne, Baudelaire, parce que je ne les avais lus qu’en partie, à cette époque-là, les livres ayant été vendus à ma mère – femme noire, femme africaine, ô toi ma mère…- sans couverture ni toutes les pages. N’empêche que c’était à chaque fois une invitation au voyage, une intime pénétration de l’étranger, une joyeuse errance solitaire ou en compagnie des personnages, un vrai régal, même si je restais régulièrement sur ma faim. Tous ces livres, pour lesquels j’étais tout à coup captif et dont il ne reste que le souvenir, avaient dû passer entre plusieurs mains, de maître en maître, rien qu’à voir leur état vieillissant pour certains, attaqués par la jaunisse ; ils atterrissaient comme des petits esclaves intelligents dans notre maison dépourvue de statuettes ; ils n’avaient pas à être revendus, je m’entêtais à soliloquer, mais a demeurer là, à se prêter librement à mon appétit de gourmet de mots, à être compulsés respectueusement ; je me devais de leur permettre d’enseigner ou disons tout court d’accomplir l’objectif pour lequel ils étaient fabriqués, édités, publiés ; je prenais leur destin en main, moi leur dernier rempart vital, de sorte qu’ils contribuassent à construire le mien. Une relation d’amitié naissait entre moi et ces auteurs lointains ; leurs esprits me nourrissaient, leurs mots étaient la sève qui finissait par couler dans mon imaginaire, l’amplifier, la gonfler, la mettre en crue comme le puissant et bouillonnant fleuve Congo, jusqu’à cristalliser des rêveries prenant forme, vivant une vie textuelle. C’est à partir de ce moment que, assez tôt, je suis devenu un rat de bibliothèque, à commencer par celle de l’église Notre Dame des Apôtres, puis celle du Djoué où j’ai lu, en classe de Troisième, dans la perspective de préparer un concours, Les Lettres persanes et L’Esprit des Lois, de Montesquieu, Les lettres anglaises et Candide de Voltaire, Le Désert des Tartares de Dino Buzzati, avant de m’inscrire à la Bibliothèque de l’écrivain congolais Guy Menga, et d’élargir plus tard ma palette de lecteur à la bibliothèque du centre culturel français (CCF) de Brazzaville.
Quel message avez-vous voulu transmettre à travers ce livre ?
Dans ce monde où la polarisation entre les individus, l’absence d’écoute et de communication prennent de plus en plus la place, ces textes, pondus pour la plupart dans une période de fracas d’ armes et de ruines de guerre, convoquent l’esprit de la paix en prônant un dialogue entre les hommes. Un manifeste implicite pour la fraternité universelle.
Où puisez-vous votre inspiration ?
Le poète s’interroge en général sur sa condition humaine, sur le monde et construit un sens, dans un usage de la langue réinventée. Ainsi je puise l’ inspiration dans ma vie du dedans et du dehors, dans la société, l’environnement, le cosmos…Les années passées dans mon pays d’origine sont le premier ferment de cet ouvrage. Issu d’une famille dite pauvre, je ne me considérais jamais pauvre, moi que personne n’attendait ; j’avais en tête l’assertion de Rilke d’après laquelle : « Si votre vie quotidienne vous paraît pauvre, ne l’accusez pas; accusez-vous plutôt, dites-vous que vous n’êtes pas assez poète pour en convoquer les richesses. Pour celui qui crée, il n’y a pas, en effet, de pauvreté ni de lieu indigent, indifférent. »
Quels sont vos projets d’écriture pour l’avenir ?
Depuis quelques jours, je me suis attelé à la rédaction d’Un rat à Paris, un roman. Devrait paraître l’an prochain, Les Lions du désert , roman sur le totalitarisme religieux, qui succède à Les morts ambulants , La kakistokratie du général Hadrien …et à On entre OK, on sort KO , écrit en 2011, histoire d’un doctorant qui fait la rencontre d’un revenant et, suite à un événement marquant, va à sa recherche dans le monde des esprits avant d’être retrouvé nu sur une tombe. Et bien sûr que j’entends publier mes recueils de poèmes inédits : Poésir, Romances du tam-tam, Long soupir, Variations poétiques, Leçon de mort, Les Mille et une femmes ou le jardin d’Éros, etc.
Un dernier mot pour les lecteurs ?
Laissez venir votre appétit de lecteur à ce recueil de poésie ! Pour ce faire, un seul petit conseil d’auteur adressé avec une bienveillante bonhomie, et sans surenchère : ne pas entrer dans cet univers avec des a priori, mais la tête ouverte, réceptive, prompt à la délectation, car vous allez à la rencontre d’une plume à laquelle vous serez éventuellement attachés. La magie devrait opérer. Pour ceux qui se désintéressent de la poésie, peut-être serait-ce l’occasion de sentir la flamme s’allumer !