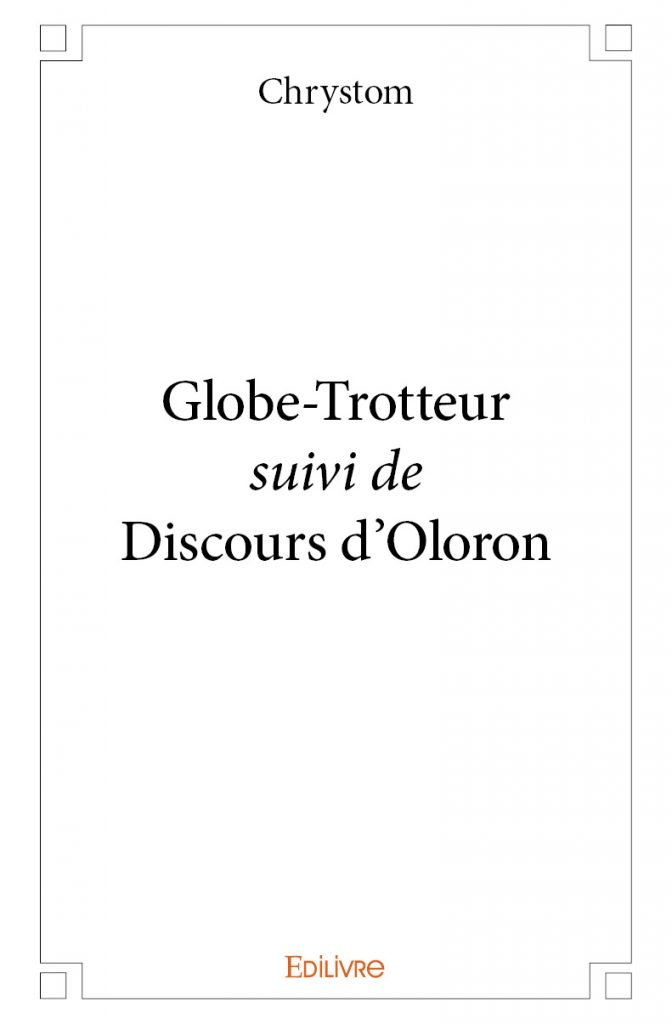
Posté par
Éditions Edilivre
Rencontre avec Chrystom, auteur de « Globe-Trotteur suivi de Discours d’Oloron »

Présentez-nous votre ouvrage.
En résumé, Globe-Trotteur suivi de Discours d’Oloron transpire ma volonté manifeste d’explorer in fine le rapport de l’homme au monde et à l’autre. Dans la préface emblématique d’un manifeste, je partage ma conception de la Mondialité mise en exergue dans le recueil de poésie. Aux antipodes des idéologies suprémacistes et dépassant la doctrine de la Négritude ainsi que son épigone, la Néo-Négritude, je plaide pour la reconnaissance du « monisme naturel du genre humain », dans un monde « post-racial » et « post-ethnique » où se réaliserait l’humain, symbole synthétique du processus dialectique fait d’antagonismes « raciaux ». Forcément, je n’ai pas pu m’empêcher de dresser un réquisitoire contre les visions essentialistes et holistiques. Et le plaidoyer, de ce livre est en faveur d’une « humanité incolore dans sa pluralité de couleurs ». Du reste, quant à sa composition, il y a évidemment un lien très étroit entre le recueil de poème, « Globe-Trotteur », et le « Discours » que j’avais prononcé à la Médiathèque d’Oloron où j’étais invité par l’Association Livres Sans Frontières pour une conférence sur Senghor et Tchicaya U Tam’Si, lors du Printemps des Poètes 2017. Je tiens d’ailleurs, ce n’est jamais assez, à renouveler mes remerciements au président de Livres Sans Frontières, Jean-Marc CROQUIN, pour l’invitation et l’hospitalité.
Quel message avez-vous voulu transmettre à travers ce livre ?
Le message, c’est à chacun de le trouver. Il ne fait pas de doute que tous n’y trouveront pas le même : c’est une question de goût, de sensibilité et d’attente.
Pourquoi avoir écrit ce livre ?
Vaste question ! Sans doute parce que, primo, il faut perpétuer le verbe insurgé du poète que je suis, un poète, faut-il le rappeler ? assigné à résistance ! Parce que, secundo, par la poésie on s’opère comme on opère en chirurgie, pour une cartographie de paix intérieure ! Parce que, tertio, la poésie est une nécessité : je suis né nu, la poésie m’habille ; elle m’habille autant que ceux qui en font leur, dans la mesure où la poésie nous place, en général, sur le piédestal d’une dimension supérieure à nous-même. Or de la nudité, que dire ? Écoutez, si tout le monde savait d’avance qu’il viendrait nu au monde, la terre serait dépeuplée ! Vu que je suis de ceux qui y sont venus, suite à une odyssée qui commence à l’état liquide, vu que je suis chantre de la Mondialité qui est, par ailleurs, un aériennisme (je veux signifier par là le fait d’être dans l’air du monde ; une certaine manière d’être aérien tout en ayant les pieds sur terre ; somme toute, un dépassement des racines enchevêtrées dans l’enferment), je ne peux pas ne pas penser le monde, et par la même occasion penser l’Homme ! Par l’Homme, j’entends celui que je suis et celui qu’est autrui. Autrui est celui avec qui nous avons non seulement des points communs, entre ressemblances et différences, mais avec qui nous avons en partage ce monde. Sa présence s’impose autant que la mienne. Sans lui, aucune société n’est possible. C’est d’une évidence claire, installée en raison. Mais autrui reste aussi ce mystère qui échappe à l’entière connaissance ; il emprunte des chemins que vous ne vous imaginiez même pas ; il offre à votre observation des actes inédits ; il réalise des désirs les plus fous, accomplit des fantasmes étonnant votre calme cervelle, met au goût du jour ce que vous auriez aimé mettre au goût du jour mais pas pour des mêmes raisons, cherche la même fin que vous mais sans user de mêmes moyens. Il est celui, à priori, dans le regard duquel vous adorerez plonger, les yeux fermés ou celui, à contrario, qui troue votre regard et qui, lorsqu’il ne veut pas croiser le vôtre, vous oblige à le détourner. Il fait partie de la famille, de la ville, du même pays, d’un autre pays, et surtout du monde. C’est celui qui est ici et maintenant ; celui qui est d’ici ou vient d’ailleurs, par pirogue dansante, par bateau ivre, par avion court ou long courrier, émigrant de Lander Road ou piéton du pont Mirabeau ; petit prince ou Cendrillon ; c’est le bourreau, c’est la victime ; c’est le nordiste, c’est le sudiste ; c’est le nommé, c’est l’anonyme ; c’est le connu, c’est l’inconnu ; celui qui s’en va loin sans avoir eu le temps de ménager sa monture, parce que pressé par les événements, ou celui qui reste ; c’est le casanier étendu nu sur son canapé, c’est le passant en mocassin de la rue Maupassant. Il est la présence parlante ou silencieuse. Silencieuse et laissant sans voix, par sa capacité à tenir longtemps en position de tombe ; ou parlante, d’une voix caverneuse qui mord l’ouïe. Allant vers son prochain, autrui, ou vivant sa si haute et bruyante solitude. Passant du temps avec vous, autrui, ou tout le temps dans l’échappée, du dedans ou du dehors. Quoiqu’il en soit, il est celui qui tombe, glisse, plonge dans le champ de notre vision, mieux de nos synesthésies, le regard marqué parfois, selon les personnes et les humeurs, en fonction de Pierre ou de Paul, marqué par la volonté de l’affirmation de soi, parfois par l’hésitation, parfois par des éructations haineuses, parfois par un radieux sourire : celui de la fraternité ou du coup de foudre fraternel !
L’autre, c’est aussi l’enfer, n’est-ce pas ?
C’est d’une évidence irréfragable que si vous demandiez crûment aux gens vivant la guerre en Syrie, au Yémen, au Kivou par exemple, ou encore en d’autres lieux connaissant une situation qui donne froid au dos, les étoiles ne s’allumant plus dans les yeux des gens, si ceux qui sont à l’origine de ces guerres meurtrières et ceux qui fusillent, massacrent, éventrent, égorgent, oppressent, asservissent sont l’enfer, ils vous répondraient, à n’en point douter, par l’affirmatif. Le résultat d’un tel « referendum » est, en effet, connu d’office. Comment voulez-vous qu’il en soit autrement pour des victimes non pas d’un petit jugement inoffensif porté sur leur personne mais d’un conflit armé nourri de tous les sifflements carnassiers du serpent des fusils et des aboiements de canons -le bruit du marteau piqueur qui mord le bitume dans l’avenue ainsi que celui de la perceuse qui pénètre une paroi chez le voisin n’étant rien à côté, juste des bébés bruits. En ce sens Sartre n’a pas tort de le souligner dans « Huis clos », l’autre devient le bourreau, manifestement ; il est celui qui empoisonne l’existence, celui qui altère, pourrit, mitraille le rapport au prochain, si bien que ce rapport paraît infernal. Il ne s’agit plus de simple regard plongeant sur vous comme une flèche qui vous persécute le mental en public, vous blessant en dedans parce que vous donnez plus d’importance au regard porté sur vous, mais dans le désastre de la guerre celui qui cause préjudice, réparable ou irréparable, met l’homme en enfer : l’enfer n’est pas plus ailleurs, à ce moment-là, que sur terre, l’enfer de Dante ! Et c’est parce que l’autre peut se montrer coupe-faim ou coupe-gorge que notre conscience est toujours en éveil ; que nous savons ce qu’est véritablement la liberté ; et que nous usons avec fermeté de notre liberté, ou luttons pour ! Ceci étant, je crois et j’espère que l’enfer n’est pas tant l’autre que l’absence de l’autre ! Je me justifie, sans justifier évidement le côté infernal qu’il peut représenter, l’autre est la porte d’entrée dans ce monde ; il est la clé de notre connaissance et de la connaissance du monde. C’est la fenêtre ouverte sur le monde. Il est certes ce sujet de conscience qui n’est pas moi – dans mon intériorité structurellement focalisée pour l’essentiel sur l’immédiat- mais contribue à l’engendrement du sujet lyrique. Il nous ouvre les yeux sur les réalités de la vie tant par sa bonne que sa mauvaise conduite. On en apprend plus, humainement, avec les autres que seul.
J’allais vous demander où puisez-vous l’inspiration. Sachant que vous parlez de monde et des autres, sachant que les autres nous entourent, sont-ils à votre sens une source inépuisable de poésie ?
Peut-être pas directement. Mais incontestablement, je répondrais par l’affirmatif. Les autres partagent notre environnement. Non seulement, ils partagent notre environnement, en plus les autres peuplent nos états d’âmes. Pas seulement nos états d’âmes : ils grouillent dans nos états de conscience : puisqu’ils sont sujets de notre perception, de notre amour, de nos souvenirs. Ils paraissent, apparaissent à nous et nous apparaissent même quand ils ne sont plus là ; c’est là toute la force de l’imaginaire, tout le pouvoir insoupçonné de la mémoire, capable de retrouver le temps perdu, de le retrouver à la Proust ; oui c’est là le creuset des potentialités infinies de l’être humain, dans toute sa finitude naturelle !
La Mondialité, que vous défendez, est fraternité, si je comprends bien.
Tout à fait. Si c’était une école de pensée, on inscrirait assurément comme devise au fronton : « Nul n’entre ici s’il n’est fraternel ». Il s’agit ici de la fraternité humaine, la fraternité universelle, attendu que je m’inscris dans une logique de reconnaissance du monisme naturel du genre humain.
Est-ce que cette fraternité universelle passe nécessairement par la reconnaissance de l’autre comme individu à part entière, égal en droit ?
Écoutez, nous sommes tous singuliers. Chacun de nous est singulier : noir, blanc, rouge ou jaune ; personne n’est vraiment jaune, rouge, blanc ou noir ; c’est un leurre du langage, un code nominaliste qui nous place dans des cadres, des rangs, des classes, des « races », et qui constitue une dénégation de la personnalité de chaque individu, son caractère, ses particularités. J’irai même plus loin : contrairement à ce que l’on croit, chacun de nous est étranger ! Étranger à l’autre. Et pas seulement à l’Arabe de Camus, au Nègre de Balzac, au vieux nègre bardé de médaille de Ferdinand Oyondo, au Nègre Blanc de Pasquet, aux Peaux-rouges criards preneurs pour cible de Rimbaud ou aux hommes qu’on croiserait suite à la Croisière jaune. Même au sein d’une famille, on ne connaît pas totalement l’autre ; tout être a un côté glissant qui, non seulement, échappe aux autres, mais lui échappe quelquefois lui-même. Nous sommes en permanence dans notre univers, intérieur et extérieur. Chacun est à la fois seul au monde, par sa conscience livrée à une éternelle solitude ; seul et à la fois toujours avec les autres, par intériorisation, et quand bien même on ne verrait plus ces derniers. Car les autres sont comme les étoiles, ce n’est pas parce qu’on ne les voit pas le jour qu’elles, les étoiles, lointaines et à moitié connues, ne sont pas là, piquées dans le ciel qu’elles enguirlandent en réalité de leur présence soupçonnable. Mais nonobstant la singularité de chacun, les Hommes sont capables de fraternité parce qu’ils sont à la base capables de s’identifier à l’autre, en tout cas à ce qui est universel en chacun et qui, comme un cordon ombilical sous-tend notre rapport à l’autre. Et je pense que, inconsciemment, notre identification à l’autre remonte à l’âge prénatal où l’on est dans une relation très nourricière avec celle qui, en état de gestation, supporte notre présence en elle, une présence plus ou moins mouvementée. Cette relation particulière à la mère, contrairement à celle qui succède à notre venue au monde, avec la coupure du cordon ombilical, est une relation de dépendance totale : la vie de l’embryon est étroitement liée à celle de la mère. Cela montre bien que notre relation à l’autre est ou devrait être nourricière. Elle participe de notre humanité, de notre santé cognitive et de notre définition en tant que sujet pensant, une définition qui n’est souvent pas définitive dans le processus évolutif de sa personnalité. Autrui, c’est donc un miroir qui nous indique qui nous sommes ; quand on l’a vu, c’est nous-mêmes que nous voyons ; à travers lui, nous nous posons des questions existentielles ou trouvons des réponses aux questions qui auraient pu se poser, nous nous construisons mentalement. En ce sens, la finalité de l’homme, c’est l’homme ! c’est-à-dire rencontrer l’humain, rencontrer l’autre. L’autre comme parcelle de l’universel, flambeau censé avoir la chaleur de la matrice qu’on quitta un jour et qui nous manque. Paraissant à la fois proche et lointain, ouvert et inaccessible, fermé et à portée, distant et présent, avec lui, c’est comme être en terre inconnue dont on connaît quelques paysages ou reliefs, puisqu’il est notre semblable. Il est, à l’insu, notre quête la plus inéluctable. C’est parce qu’il est que nous sommes. Par lui nous sommes, avec une connaissance de nous-même et du monde. S’installe une relation d’interdépendance latente à la lisière d’une spiritualité générale et planante de l’universalité, autant dans son horizontalité que sa verticalité.
La Mondialité c’est donc aussi un refus d’être défini de façon réductrice ?
Évidemment ! On devrait tous être furieux d’être définis de façon réductrice, en l’occurrence lorsque la définition n’est pas vôtre mais collée à votre personne par d’autres, sachant que d’elle dépend parfois votre destin. Or c’est le quotidien de quantité de gens. Ce que nous sommes n’est pas réductible à ce que contient notre pièce d’identité ou au travail que l’on fait ou encore à la couleur de notre peau, si ce n’est celle de nos origines – origines à tous qui, selon les scientifiques, sont africaines. Réduire la définition d’une personne à son ethnie ou à la couleur de sa peau par exemple est d’une absurdité abasourdissante. Et on sait combien une telle définition réductrice équivaut à des carabistouilles qui, au mieux, enfument des consciences somnolentes et, au pire, enfantent des malheurs gangrenant la vie sociétale. Être blanc, jaune, rouge, gris ou vert, c’est toujours le regard de l’autre qui se dresse sur l’enveloppe apparente et s’adresse, sur le fondement d’une codification statique qui semble refuser toute évolution. La couleur de la peau devenant alors une grille de lecture qui place les uns et les autres dans des cases juxtaposées d’où ils ne doivent surtout pas sortir. Le mensonge du langage et le poids des traditions font que l’un soit dit jaune et l’autre blanc ou rouge alors qu’intérieurement ils sont incolores. D’ailleurs, c’est parce qu’on est incolores en soi que les gens physiquement de couleurs différentes se rencontrent, se marient, ont des descendants, comme s’ils étaient d’une même couleur. Parce que, de même que cette lumière en nous qui capte ce qui se passe en dedans ou en dehors est incolore, de même l’amour est incolore ! Et donc, si l’amour n’a pas de couleur, c’est parce que l’humanité n’en a pas non plus ! C’est la raison principale pour laquelle je récuse la notion de « race » et toute la rhétorique identitaire qu’elle engendre non sans germination de maux pervertissant le rapport à l’autre ou disons non sans enfantement de la « crise de l’esprit » pour emprunter les mots de Paul Valéry !
Grain de Paix, Grain d’amour se distinguait déjà par sa finalité non moins utilitaire. Ce dernier né n’échappe pas à cette logique. C’est bien réfléchi tout cela, je présume.
Vous n’avez pas tort. Pour avoir vécu la guerre, connu des conflits armés, je ne vois plus l’intérêt de ne faire que de la poésie pour la poésie, à l’image de ceux qui faisaient de l’art pour l’art. J’aime lire toute poésie à ma portée, toute poésie. Mais de là à croire que j’aurais aimé écrire comme quelques-uns de leurs auteurs, pour lesquels j’ai, du reste, du respect, ce serait une outrageuse aberration. Je ne suis pas de la trempe de certains poètes syphilitiques ou tuberculeux qui chantaient, et aujourd’hui encore, sous l’arc-en-ciel lumineux d’un ciel à moitié voilé, les fleurs, la rosée léchant la feuille, l’éclat de la zébrure de foudre dans le ciel, la beauté des oiseaux et des étoiles naissantes, le lapin qui cochonne la lapine, pendant qu’étaient violées des petites filles, pendant que crevaient comme des mouches ou des rats pestiférés, à coup de mitraille, de la façon la plus crapuleuse, ignoble, horrible, crevaient des petits garçons qui naissent aussi des étoiles et que les mères inconsolables, d’avoir perdu des mômes, ne tarissaient plus de larmes, ces mères qui ont fait apparaître, au monde, ceux que les autres se sont chargés de faire disparaître. Et ailleurs, sous les yeux attendris, ébahis et tombants des buveurs de propos des seconds comparateurs de la femme à une rose, à défaut d’une fermentation du verbe, ces seconds comparateurs s’applaudissaient des pieds et des mains tandis qu’on coupait des mains à quelques encablures de là. Ce n’est pas un blâme gratuit : sans doute rappellent-ils l’importance de la goutte d’eau dans la vie humaine. Mais à savoir s’il faut s’arrêter à la goutte d’eau, s’y éterniser et mettre sous couvert la réalité épouvantable de la tête coupée ou s’arracher à la goutte d’eau et brosser des tableaux répondant à l’urgence du présent, le choix est vite fait. Voilà pourquoi l’écriture est pour moi une nécessité et non une contingence. Voilà pourquoi aussi bon nombre de mes poèmes sont ceux où se joue la tragédie : la tragédie de l’âme secouée ! Vous l’avez compris, une façon de souligner qu’aux poésies qui parlent, qui ronflent de parler ou qui parlent pour rien du tout, je préfère celles qui disent. Quand on n’a pas à dire, on devrait se taire ou s’employer à raconter des histoires aux petits enfants. Ainsi, je pense être condamné à produire de la poésie qui dit.
Un exemple de poésie qui dit.
Un ? Pourquoi pas deux, trois, quatre ! Je taquine bien sûr. Évoquons celle de Hugo, celle de Whitman, celle d’Éluard, celle de Maïakovski, celle de Prévert et bien d’autres… qui réveillent et incitent à penser l’existence. Ce sont des accélérateurs de conscience, comme dirait Roberto Juarroz. Après, n’allez pas vous imaginer que prendre fait et cause annihile toute propension formelle. Non. L’utilité, résultat de l’urgence du présent, n’empêche pas les poèmes d’être des sculptures de mots. En revanche, celles-ci n’ont pas pour seule finalité qu’elles-mêmes ! Enfin, j’espère… On est appelé à rester dans la fête du langage dans le langage, véhicule de la pensée.
On découvre dans Globe-Trotteur des associations troublantes. Je citerai par exemple « Train de caresses trame de viscères », « Baiser pour baiser rage pour rage chair pour chair payée ».
Je laisse découvrir. En un mot, d’une part, par le biais de « caresses » prodiguées et de « viscères » répandus, je revisite le rapport qu’il y a entre le topique de l’amour et celui de la guerre ; d’autre part, l’évocation de « chair payée » renvoie à la question générale de l’indisponibilité du corps humain avec son digne pendant naturel qui est la non marchandisation du corps, en vertu du droit positif. Mais la réalité est tout autre, elle outrepasse parfois ces principes juridiques face auxquels notre Blaise Pascal international aurait pu dire, à la suite de Montaigne : « Vérité en deçà des pyrénéens, erreur au-delà. »
Vous, héritier de la gâchette de l’Afrique, écrivez-vous. C’est incendiaire, non ?
Pas du tout. C’est une façon de relever que j’ai des racines africaines, que je suis fait de la poussière de ce continent, que j’ai été en partie nourri de sa terre, de sa littérature, de ses contes et légendes, qu’en conséquence l’Afrique m’habite autant que ceux qui l’habitent : je suis un enfant du monde originaire d’Afrique. Mais la composition du tableau ne serait pas achevée si je ne mentionnais le point de départ de ce vers : l’Afrique a la forme d’un revolver dont la gâchette se trouve au Congo. Est-ce parce qu’elle a cette forme que les guerres persistent, perdurent en Afrique ? Rien n’est moins sûr. Est-il qu’ici le revolver est, par ailleurs, la métaphore de la plume : la seule arme dont dispose le poète ! La même arme qui permet d’éclabousser ce qui semble être des certitudes intangibles, à commencer par des traditions aveugles et injustes qui ne sont pas jugées à la lueur du « voile de l’ignorance » auquel ferait allusion John Rawls !
Avec la recrudescence des conflits armés que vous évoquiez dans l’avant-propos à Grain de paix, Grain d’amour ne vous arrive-t-il pas de désespérer complètement de l’humanité ? Faut-il continuer à croire en la puissance de l’esprit humain ?
Il faut bien. Il faut bien continuer, je pense. Autrement, tous les hommes cherchant le bonheur, on irait chercher ce bonheur dans la pendaison. Il y a survivance d’une sacrée pointe d’optimisme ! Le désespoir, puisque que j’en ai, le désespoir porte beaucoup plus sur la banalisation de la guerre, son anormale acceptation, l’indifférence qui l’entoure, les yeux des uns et des autres fermés et les oreilles bouchées pour ne pas entendre les cris des mourants, ne pas voir les images macabres pendant qu’on mange tranquillement qui son poulet à bicyclette, qui son ndolé, qui sa tarte à la frangipane, qui son kimchi, qui son hot-dog, qui sa sauce à la mwabe, en se pourléchant les lèvres, au milieu de la bave écumeuse du crapaud-bœuf animé par la volonté de faire montre de son instinct carnassier, et enfin qui sa forêt noire fait de chocolat issu des plantations où les travailleurs adultes et mineurs connaissent la servitude, l’esclavage !
Si ce livre était une peinture, quelle serait-elle ?
J’hésite entre le Cri de Munch et la Liberté guidant le peuple ! Par ailleurs, sachant que je nais de façon renouvelée à chaque création, j’aurais aussi pu choisir La Création d’Adam, l’une des neuf fresques peintes par Michel-Ange au centre de la voûte du plafond de la chapelle Sixtine.
Si vous deviez mettre en avant une strophe de ce livre, laquelle choisiriez-vous ?
En vérité, j’en choisirais plusieurs. Mais pour aller au bout de la logique, à propos de la fresque de Michel-Ange, je dirais plusieurs strophes à l’instar de celle, très simple, qui me rappelle mon enfance d’enfant de chœur, dans une famille œcuménique formée par un père catholique et une mère protestante, un peu à l’image d’Élisabeth I qui tint en échec la prétendue invincible Armada de Philippe II d’Espagne :
J’ai bu le sang du Christ
J’ai mangé de sa viande. La seule qui en valait la peine
Sans être taxé de cannibale.
Mais ne vous leurrez pas : si j’ai choisi celle-là, c’est parce qu’elle titille la sensibilité. Sensibilité aussi bien des croyants que des agnostiques, en ces temps troubles où la religion est un sujet brûlant. Un lecteur y a vu une évocation sous-jacente de la portée de l’histoire coloniale. Chacun se fait son opinion.
À quel lecteur s’adresse votre ouvrage ?
Dans l’idéal, le mieux serait qu’il soit à la portée du plus grand public possible pour un partage large. En tout cas, qu’il trouve le premier, le deuxième, le troisième lecteur est toujours un bon début ! Et je sais qu’il y a un lectorat devant, un lectorat de la première heure à qui je sais gré de faire vivre le livre, un lectorat qui est en attente de ce nouveau cru, ce nouveau-né. C’est un honneur irréversible pour un volume que d’être attendu, quel que soit le nombre de ceux qui l’attendent ! Que serait l’écrivain sans les fantassins de la littérature que sont les lecteurs ? Merci à eux…
Quels sont vos projets d’écriture pour l’avenir ?
Plusieurs projets en vue. Pour l’instant, disons qu’écrire demeure mon acte de respirer. Et la plume est mon collant : un éternel partenaire. Alors pourquoi arrêter, si le volcan n’est point définitivement éteint ? Je laisse découvrir la suite de cette aventure autour des livres. On se donne rendez-vous dans quelque temps.
Un dernier mot pour les lecteurs ?
Je ne savais pas que c’était impossible, alors je l’ai fait… Et, sauf de joie mes amis, que personne ne pleure avant d’avoir mal ! Tous mes vœux les meilleurs, dans la fraternité humaine…à toutes et à tous, des larmes de joie !
